Comment améliorer l’acceptabilité de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) en France ? Une étude qualitative originale avec des focus groups comprenant des parents et des personnels de l’Éducation Nationale, interrogés séparément
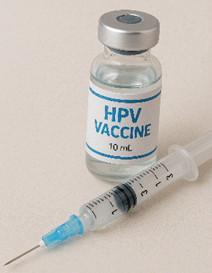
Version Pdf
Julien Ailloud1, et la classe de Terminale ST2S du lycée Geneviève Vincent de Mme Emilie Rosier2 (la liste des élèves est mentionnée en fin d’article)
Article original/Original article: Ailloud, J., Branchereau, M., Fall, E., Juneau, C., Partouche, H., Bonnay, S., Oudin-Doglioni, D., Michel, M., Gagneux-Brunon, A., Bruel, S., Thilly, N., & Gauchet, A. (2023). How can we improve the acceptability of vaccination against Human Papillomavirus (HPV) in France? An original qualitative study with focus groups comprising parents and school staff, interviewed separately. Vaccine, 41(31), 4594‑4608. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.05.072
Institution : 1Université Grenoble Alpes, Bâtiment Michel Dubois, 1251 rue des universités – 38610 GIERES, France
2Lycée Polyvalent Geneviève Vincent, 15 Boulevard du Général de Gaulle 03600 Commentry
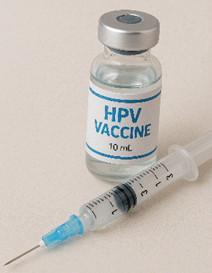
Résumé :
Contexte Le vaccin contre les papillomavirus humain (HPV) protège efficacement contre certaines infections : les verrues génitales et les cancers du col de l’utérus. Pourtant, en 2021, seulement 37,4 % de la population française possède une couverture vaccinale contre les HPV en France, ce qui est l’un des taux les plus bas d’Europe. Pour comprendre pourquoi, des chercheurs ont organisé des discussions en groupe avec des mères et des membres du personnel éducatif. L’objectif ? Mieux saisir leurs connaissances, leurs opinions et les obstacles à la vaccination.
Méthode Entre janvier 2020 et mars 2021, 29 personnes ont participé à ces discussions : 15 mères d’adolescents, scolarisés au collège et 14 membres du personnel éducatif. Les chercheurs ont analysé leurs échanges à l’aide d’hypothèses afin d’identifier les idées et croyances qui influencent cette vaccination.
Résultats Plusieurs éléments jouent un rôle dans la décision de vacciner ou non : les connaissances et perceptions du HPV et du vaccin ainsi que les sources d’information utilisées pour se renseigner
Les mères ont évoqué :
• L’importance du suivi gynécologique
• Leur méfiance envers les laboratoires pharmaceutiques
• Le manque de fiabilité d’internet pour s’informer
Le personnel éducatif, lui, a souligné :
• L’influence des croyances culturelles et religieuses
• Le rôle des municipalités dans la diffusion des infos
• Les dilemmes éthiques et les contraintes logistiques pour vacciner en milieu scolaire
Conclusion Cette étude met en lumière les facteurs qui pourraient améliorer ou freiner l’acceptation du vaccin. Ces résultats aideront à créer un programme d’information destiné aux médecins, enseignants, parents et adolescents, pour encourager cette vaccination.
Mots clés : Opinion ; Papillomavirus humains (HPV) ; Parents ; Personnel éducatif ; Vaccination
I. Introduction
En 2013, l’OMS a publié que 210 000 femmes sont décédées suite au cancer du col de l’utérus, qui est un problème de santé publique majeur. Pourtant, il pourrait être largement évité grâce à la vaccination contre les papillomavirus humain (HPV), qui protège contre 90 % des infections cancéreuses.
Chaque année, environ 342 000 femmes meurent du cancer du col de l’utérus dans le monde, un chiffre en hausse par rapport aux 270 000 femmes décédées estimées en 2013. Pourtant, ce cancer pourrait être évité dans la grande majorité des cas grâce au vaccin contre les papillomavirus humain (HPV), qui protège contre 90 % des infections responsables de ces cancers. Malgré son efficacité prouvée, la France a l’un des taux de vaccination les plus bas d’Europe. En 2018, seulement 23,7 % des filles de 16 ans avaient reçu toutes leurs doses, et même si ce chiffre est monté à 37,4 % en 2021, il reste loin des objectifs fixés par l’État (60 % en 2023 et 80 % en 2030).
Le problème vient en partie de l’hésitation vaccinale, un phénomène bien ancré en France. Beaucoup de gens se méfient des vaccins, en partie à cause des débats sur leur efficacité et leurs effets secondaires. Même certains médecins hésitent : 1 sur 4 ne recommande pas toujours le vaccin HPV. Depuis 2019, le vaccin est aussi proposé aux garçons de 11 à 14 ans, mais cette information est encore peu connue. Contrairement à d’autres pays européens où la vaccination se fait directement à l’école, la France ne l’a pas encore généralisée dans les collèges, ce qui complique son accès (en 2021 lors de l’écriture de l’article).
Cette étude cherche donc à comprendre ce qui bloque la vaccination en interrogeant les parents et le personnel scolaire, deux acteurs clés dans la décision de faire vacciner les ados. L’objectif est de trouver des solutions pour mieux informer et rassurer les familles, afin d’augmenter la couverture vaccinale et mieux prévenir les cancers liés aux HPV.
II. Méthode
1. Conception de l’étude
Cette étude fait partie du projet “PrevHPV”, lancé en 2019, qui réunit huit équipes de recherche en France. Le projet a trois grandes phases : diagnostic, co-construction et expérimentation. L’étude a eu lieu lors de la première phase, qui visait à comprendre ce que les gens savent et pensent des HPV (papillomavirus humains) et de la vaccination contre les HPV.
Les chercheurs ont utilisé des focus groups pour cette étude. Un focus group est une méthode de discussion de groupe qui permet de recueillir différentes opinions et perceptions des participants sur un sujet donné. Cette méthode est efficace pour explorer des idées et des points de vue variés, notamment sur des sujets comme la vaccination contre les HPV. Le but était de comprendre les facteurs influençant la vaccination, en classant les opinions des participants selon le modèle COM-B (capacité, motivation, opportunité) pour ensuite proposer des recommandations d’intervention.
2. Recrutement des participants
L’étude a ciblé quatre régions de France : Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, et Pays de la Loire. Ces régions sont très variées sur le plan démographique, géographique et socio-économique, et elles ont aussi des taux de vaccination contre les HPV différents. Par exemple, certains endroits ont un taux de vaccination plus élevé que d’autres.
Plus de 60 collèges ont été contactés pour participer à l’étude. Au départ, 27 ont accepté, mais à cause des changements liés à la situation sanitaire (période COVID-19), seulement 13 ont réellement participé. Chaque collège a envoyé un email aux parents et au personnel scolaire pour les informer sur l’étude et les inviter à remplir un questionnaire en ligne, en expliquant leurs connaissances et leurs opinions sur la vaccination. Ceux qui étaient intéressés pouvaient ensuite s’inscrire pour participer à un groupe de discussion. Au total, 29 personnes ont participé aux focus groups.
3. Collecte des données
Nous avons organisé entre 3 et 6 groupes de discussion pour chaque groupe cible (parents et personnel scolaire). En général, ce nombre est suffisant pour recueillir toutes les informations nécessaires. Ces groupes étaient composés de 5 à 8 participants et étaient animés par des chercheurs expérimentés. Chaque groupe était guidé par un ensemble de questions prédéfinies pour explorer les connaissances et opinions sur les HPV et la vaccination. Par exemple, nous avons posé des questions sur les attitudes envers la vaccination, les obstacles perçus, et sur le rôle de l’école dans la promotion de la vaccination.
Les discussions ont été enregistrées (avec le consentement des participants) et retranscrites pour pouvoir analyser les réponses. Chaque participant a reçu un bon d’achat de 20 € en remerciement de sa participation.
4. Analyse et interprétation des données
L’analyse des données a été réalisée grâce à une méthode appelée analyse de contenu thématique. Cela consiste à identifier les thèmes principaux qui émergent des discussions. Les chercheurs ont d’abord analysé les réponses de chaque groupe séparément, puis ont comparé les résultats entre les deux groupes (parents et personnel scolaire).
Pour garantir la qualité de l’analyse, plusieurs chercheurs ont relu et discuté des résultats ensemble. Après avoir identifié les thèmes principaux, une grille d’analyse finale a été créée, permettant de mieux comprendre les idées clés et les différents points de vue des participants.
III. Résultats
L’étude a été menée auprès de mères et de personnel scolaire pour comprendre leurs connaissances et perceptions des papillomavirus humain (HPV) et du vaccin associé. Il en est ressorti un manque d’information généralisé.
Les participants, qu’ils soient parents ou membres du personnel scolaire, avaient peu de connaissances sur le HPV et la vaccination. Beaucoup pensaient que cette infection ne concernait que les femmes et associaient exclusivement le vaccin à la prévention du cancer du col de l’utérus. Peu savaient que les garçons pouvaient aussi être vaccinés.
Cependant, certaines personnes étaient mieux informées et savaient que les HPV pouvait provoquer d’autres maladies comme les condylomes (verrues génitales). Elles reconnaissaient aussi l’importance du dépistage régulier via le frottis.
1. Les freins à la vaccination :
Plusieurs obstacles à la vaccination ont été identifiés :
• L’âge des enfants : Certains parents trouvaient que 11 ans était trop tôt pour un vaccin lié à la sexualité.
• Le manque de consensus médical : Les médecins ne donnaient pas tous le même avis sur la vaccination, ce qui créait de la confusion.
• Les doutes sur le vaccin : Les participants avaient peur des effets secondaires et se demandaient si le vaccin était vraiment efficace.
• La méfiance envers les laboratoires pharmaceutiques : Certains parents se méfiaient des entreprises qui fabriquent les vaccins.
• Les tabous culturels et religieux : Dans certaines communautés, parler de sexualité reste un sujet délicat, ce qui complique la sensibilisation aux HPV.
• Le manque de temps des médecins : Beaucoup de parents trouvaient que les consultations étaient trop rapides et que le sujet n’était pas abordé avec eux.
2. Les facteurs favorisant la vaccination :
Malgré ces freins, plusieurs éléments pourraient encourager la vaccination :
• Mieux informer les familles : Des campagnes d’information plus claires et accessibles pourraient aider à convaincre les parents.
• Montrer l’exemple d’autres pays : En Italie ou au Québec, la vaccination contre les HPV est bien acceptée, ce qui pourrait inspirer la France.
• Former les professionnels de santé : Une meilleure formation des médecins et infirmiers aiderait à avoir un discours plus homogène sur le vaccin.
• Rendre le vaccin obligatoire : Certains participants pensaient que cela pourrait augmenter la couverture vaccinale.
3. Les sources d’information et le rôle des parents :
Les parents cherchaient des informations principalement auprès des médecins, mais aussi sur Internet et dans la presse. Cependant, ils doutaient parfois de la fiabilité des sources en ligne.
Le médecin était souvent la personne de confiance qui influençait la décision de vacciner ou non. La discussion avec la famille et les amis jouait aussi un rôle important.
En général, la décision de vaccination était prise par les parents, mais certains adolescents participaient aussi à cette réflexion.
4. La vaccination dans les collèges : une idée controversée :
L’idée de vacciner les adolescents directement à l’école divisait les participants.
Certains évoquaient des arguments en faveur :
• Certains parents et membres du personnel scolaire estimaient que cela pourrait être une bonne solution, à condition que les familles soient bien informées et donnent leur accord.
• Des campagnes de vaccination en milieu scolaire avaient déjà été organisées par le passé, comme pour la grippe H1N1.
Et d’autres abordaient des arguments contre :
• Certains craignaient que cela ne soit perçu comme une vaccination “de masse” imposée.
• La logistique et le manque de personnel dans les écoles rendaient cela compliqué.
• Parler de vaccination contre une infection sexuellement transmissible dans un cadre scolaire pouvait gêner certaines familles.
• Certains craignaient que cela ne crée des tensions entre élèves (jugements entre vaccinés et non vaccinés).
En conclusion, bien que la vaccination en milieu scolaire puisse être une solution, elle nécessiterait une organisation rigoureuse et l’adhésion des familles et des écoles.
IV. Discussion
1. Résultats principaux
Les mères et le personnel scolaire disent ne pas avoir assez de connaissances sur les papillomavirus humains (HPV) et, dans une moindre mesure, sur le vaccin qui existe pour les prévenir. Ce manque d’information est similaire à celui observé dans d’autres pays, comme en Afrique de l’Est. Ce manque de connaissances rend difficile la décision des mères de faire vacciner leur enfant et complique la communication entre les personnels de l’EN et les élèves. En général, les gens ne sont pas mal informés, sauf sur la question de la vaccination des garçons, qui est encore mal connue. Cela s’explique par le fait que la recommandation de vacciner les garçons contre les HPV a été faite en 2019, mais la couverture par la sécurité sociale n’a été mise en place qu’en 2021, avec des campagnes d’information qui ont commencé à ce moment-là.
Les mères et les personnels de l’EN s’informent de manière différente sur les HPV et le vaccin. Les sources d’information les plus courantes sont la famille, les amis, et les médecins. Les médecins jouent un rôle très important, car les gens leur font confiance. Si des campagnes d’information étaient mises en place dans les collèges, cela pourrait aider à mieux informer la population, comme cela se fait déjà en Suède, au Canada, et en Australie. Certains parents et personnels de l’EN pensent que la vaccination pourrait être faite à l’école, à condition que les parents soient informés et donnent leur accord.
2. Forces et limites de l’étude
Cette étude est importante pour mieux comprendre comment informer la population sur les HPV et la vaccination. Elle a permis de repérer des points communs et des différences dans les avis des mères et des enseignants, ce qui peut aider à adapter les messages de santé publique.
Cependant, il y a quelques limites à cette étude. Par exemple, les participants ont été choisis de manière volontaire, ce qui veut dire qu’ils étaient probablement déjà mieux informés que d’autres sur le sujet. De plus, il y a eu quelques groupes de discussion avec seulement deux participants, ce qui limite la diversité des opinions. Le fait que l’étude ait eu lieu en grande partie pendant la pandémie de COVID-19 pourrait aussi avoir influencé les réponses des participants, car les vaccins étaient un sujet très discuté à ce moment-là.
3. Implications pour le programme Prev HPV et la santé publique
Les campagnes de santé publique ciblent principalement les collégiens, et les infirmières scolaires jouent un rôle central pour informer les élèves et leur famille. Il est important que ces infirmières aient les dernières informations sur les HPV et la vaccination, car elles sont en contact direct avec les élèves.
Les autres enseignants, notamment ceux qui s’occupent de l’éducation à la santé, doivent également être bien formés. Cependant, il est souvent difficile pour les écoles de disposer de toutes les ressources nécessaires pour organiser des sessions d’information et de vaccination. Les collectivités locales pourraient aider les écoles en fournissant des moyens pour organiser des journées de vaccination et des ateliers d’information.
Les parents, surtout les mères, jouent un rôle essentiel dans la décision de faire vacciner leurs enfants. Organiser des réunions où les parents peuvent obtenir des informations sur les HPV et poser des questions à des professionnels de la santé pourrait les rassurer et les aider à faire le bon choix.
Les médecins généralistes peuvent également jouer un rôle clé en conseillant les parents et en les incitant à faire vacciner leurs enfants. En leur donnant les bonnes informations et en les formant, on pourrait réduire l’hésitation vaccinale.
Enfin, des initiatives comme des formations en ligne pour les médecins, des sessions d’éducation pour les élèves et leurs parents, ainsi que des journées de vaccination dans les collèges pourraient aider à augmenter le taux de vaccination. Ces mesures devraient être mises en place et évaluées dans le cadre du programme Prev HPV, afin de lutter contre les HPV de manière efficace.
V. Conclusion
La France a une relation compliquée avec la vaccination. Pour mieux comprendre les freins au vaccin contre les HPV, des discussions ont été menées avec des mères et du personnel scolaire. Résultat : il faut mieux informer, sensibiliser et mettre en place une politique de santé plus ambitieuse. Trois solutions sont proposées : former les médecins, informer les collégiens et leurs parents, et organiser des journées de vaccination dans les collèges (ce qui est maintenant d’actualité puisque l’article date de 2021).
Références :
Ont participé au travail d’écriture de cet article, en collaboration avec Julien Ailloud, chercheur en psychologie (par ordre alphabétique) : AUBAILLY Amandine, AUMENIER Elora, AVIGNON Mathis, BERTIN Lyse, BICHARD Lilou, BOUCAUD Lou, CHARBONNEL MALVAUX Gladys, COLOMBIER Cléa, DAVIOT Charlotte, DECHAUMES Morgane, DEJEAN Léa, DELPUECH Clarisse, DE OLIVEIRA Samuel, DUCOURTIOUX Justine, DUFAL Louane, DUFLOUX Laura, ENYIME MABATTO Héléna, GERCEK Meryem, GUEGBELET Olivia, LIMOGES Emma, MARKOV Laura, MISANDEAU Kimberly, MOUCHOT James, ROSARIO FAUCHET Emilly, ROUSSEL Lilou, VANDEPOELE Nina, YAPICI Emine.
Comment citer cet article : Julien Ailloud et la Terminale ST2S du lycée Geneviève Vincent (Commentry, FR), Comment améliorer l’acceptabilité de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) en France ? Une étude qualitative originale avec des focus groups comprenant des parents et des personnels de l’Éducation Nationale, interrogés séparément Journal DECODER, 2025-04-24
